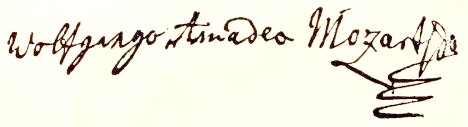

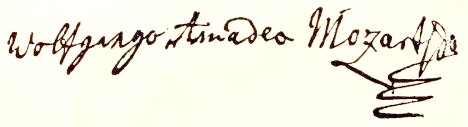 |
 |
| Catalogue
Kochel
|
Symphonie n°25 en sol mineur K183 Elle est écrite pour 2 violons, alto, 2 hautbois, 4 cors, violoncelle et basse (plus 2 bassons dans l'Andante). Durée d'exécution : 28 minutes environ. Si l'influence de Haydn ainsi que celle d'un compositeur aujourd'hui
oublié, Vanhal, sont sensibles dans cette oeuvre qui semble avoir été composée à la
fin de 1773, si l'on ne peut négliger non plus l'apport des poètes et romanciers du
Sturm und Drang, elle n'en reste pas moins le témoignage d'une maîtrise d'écriture qui
en fait comme la plupart des commentateurs le font remarquer, le prototype de la grande
Symphonie en sol mineur (K550), de 1788. 1 Deux sujets forment la trame de l'Allegro con Brio (à 4/4), qui en constitue le mouvement initial. Le premier est en deux parties, et tout à fait remarquable : après quatre mesures d'introduction, la mélodie s'élance sur un rythme fébrile que maintiendront les cordes, tandis que le hautbois se verra confier le chant, rendu encore plus tendu par l'emploi des syncopes et des imitations. Plus anodin, par volonté de contraste, le second sujet en majeur, très court, aboutit à une ritournelle qui, reprenant le rythme implacable du début, débouche sur le développement animé par la même énergie impulsive, tandis que les bois font entendre certains échos du premier sujet. Peu à peu la tension se relâche ; mais le répit est bref : les vents à découvert ne tardent pas à ramener les premières mesures de l'introduction, et la rentrée se déroule avec un changement notable puisque la deuxième partie du premier sujet, ainsi que le second, sont maintenant en mineur, prenant définitivement une couleur pathétique. 2 L'Andante en mi bémol (à 2/4), dont la douceur délicate fait oublier la violence de ce qui précède, séduit davantage par le jeu de contrepoint auquel se livrent les instruments, et par les colorations qu'apportent au chant les bassons et les hautbois, que par la mélodie elle-même, formée de deux sujets. Après quelques mesures des vents à découvert, suivies d'une cadence des violons qui clôt le développement, la rentrée survient, augmentée, après le premier sujet, d'un passage nouveau que des modulations mineures teintent de mélancolie, donnant soudain à cette page une gravité insoupçonnée. 3 Menuetto (à 3/4) : rien de plus déconcertant que l'atmosphère de ce mouvement, dont le chant ne se départit à aucun moment d'une nostalgie pénétrante. La première partie en mineur en est reprise, variée, après la seconde, et suivie d'une coda. Le trio est tout entier confié aux vents, et la clarté de leurs sonorités, ainsi que la lumières de la tonalité de sol majeur, apportent un peu de sérénité au sein de ces quelques minutes dont le sentiment reste indéfinissable. 4 Avec le finale Allegro (à 2/2), voici à nouveau
l'effervescence inquiète du mouvement initial, manifeste dès l'exposition du premier
sujet, malgré une réponse en majeur. C'est ce même sujet qui fournira la transition
introduisant le second, et c'est encore lui qui sera présent en filigrane tout au long du
développement, sous l'apparence de dessins mélodiques nouveaux aux modulations
pathétiques. Peu de changements dans la rentrée, suivie d'une coda d'une dramatique
énergie, sur le rythme obsédant du premier sujet, tendu à l'extrême. Source : Fayard - Guide de la musique symphonique |